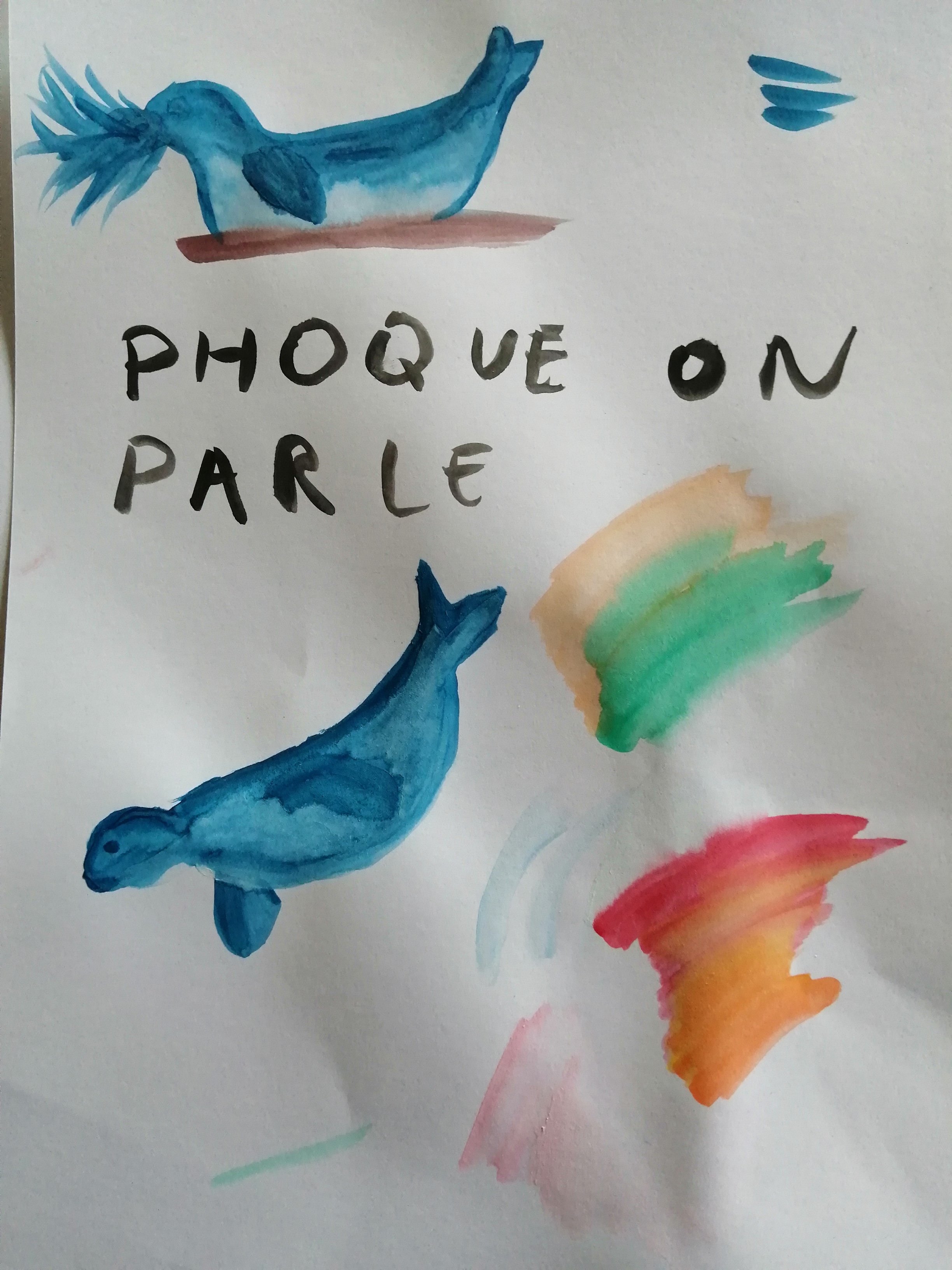Lima, la ville entre trois infinis
Lima est à la rencontre de trois infinis, dit-on : l'océan, le désert et les Andes. Dans Moby Dick, Melville fait dire à l’un de ses personnages qu'il s'agit de la ville la plus étrange et la triste au monde. Je ne la connais qu'en hiver, où son ciel est d'un gris blanc et s'émiette en faisant une bruine grumeleuse, qui crépite doucement sur votre visage : la garúa. En début d'après-midi, au pic de la luminosité du jour, le ciel est pris d'une clarté irréelle, une pâleur de lampe chirurgicale. A force, on oublie la possibilité du soleil.
“The strangest, saddest city thou can’st see.”
Elle abrite le bordel immense d'une ville sud-américaine, congestionnée à mort, où des vies entières se passent en voiture, à se ravitailler aux vendeurs de nourriture des feux rouges. En taxi, on traverse des mondes, depuis les immeubles miséreux en briques nues de Callao jusqu’aux bâtisses chics de San Isidro ou Miraflores. Là, on arrive au bout de l’univers, aux falaises noires d'où on voit les vagues plisser le gris Pacifique comme une pièce de métal repoussé. Au sud, un immense crucifix lumineux sur un piton rocheux.
Les fenêtres situées à l’arrière du palais présidentiel donnent sur le quartier de Rímac et la rivière du même nom, qui pue l'ordure, enjambée par un pont où passe l'héroïne de la chanson de Chabuca Granda, "La flor de la canela". Un quartier de maisons coloniales croulantes, entre lesquelles bruissent un marché de breloques et les cris de vendeurs de nourriture de rue. Le coin est dangereux. Un policier militaire équipé d'un fusil automatique monte la garde. C'est comme si le palais de l'Elysée plongeait sur les pires endroits de La Courneuve ou de Bagneux. Derrière Rímac, une montagne aux pentes occupées par le bidonville de San Cristobal, surmontée d’un grande croix. Encore une.
Lima est fendue par une autoroute intérieure, où croisent des SUV, des voitures déglinguées et des carrioles tirées par des motos. C’est une large saignée surmontée d'immenses panneaux publicitaires où défilent les plus beaux rêves consuméristes. Là, les arrêts de bus ressemblent à des capsules spatiales larguées au milieu de la circulation chaotique. Un homme observe le trafic, accoudé au rail de sécurité en béton. Couché sur un talus, un autre se gratte frénétiquement la tête.
Dans le centre historique, le calme se trouve dans la paix bétonnée des églises du quartier, surtout de la Merced, peinte d’orange et de jaune tendres, devant ses grandes chapelles où s'élèvent de hauts autels de bois sombre, dans lesquels trônent des vierges.
Lima est porteuse d’une mélancolie bizarre et frénétique. Malgré l’inflation, l’incurie politique et la violence, elle vit, dans l’attente du prochain tremblement de terre, portée par une mélancolie vivace, bien jeune et vivante, qui diffère de la tristesse et de la nostalgie.