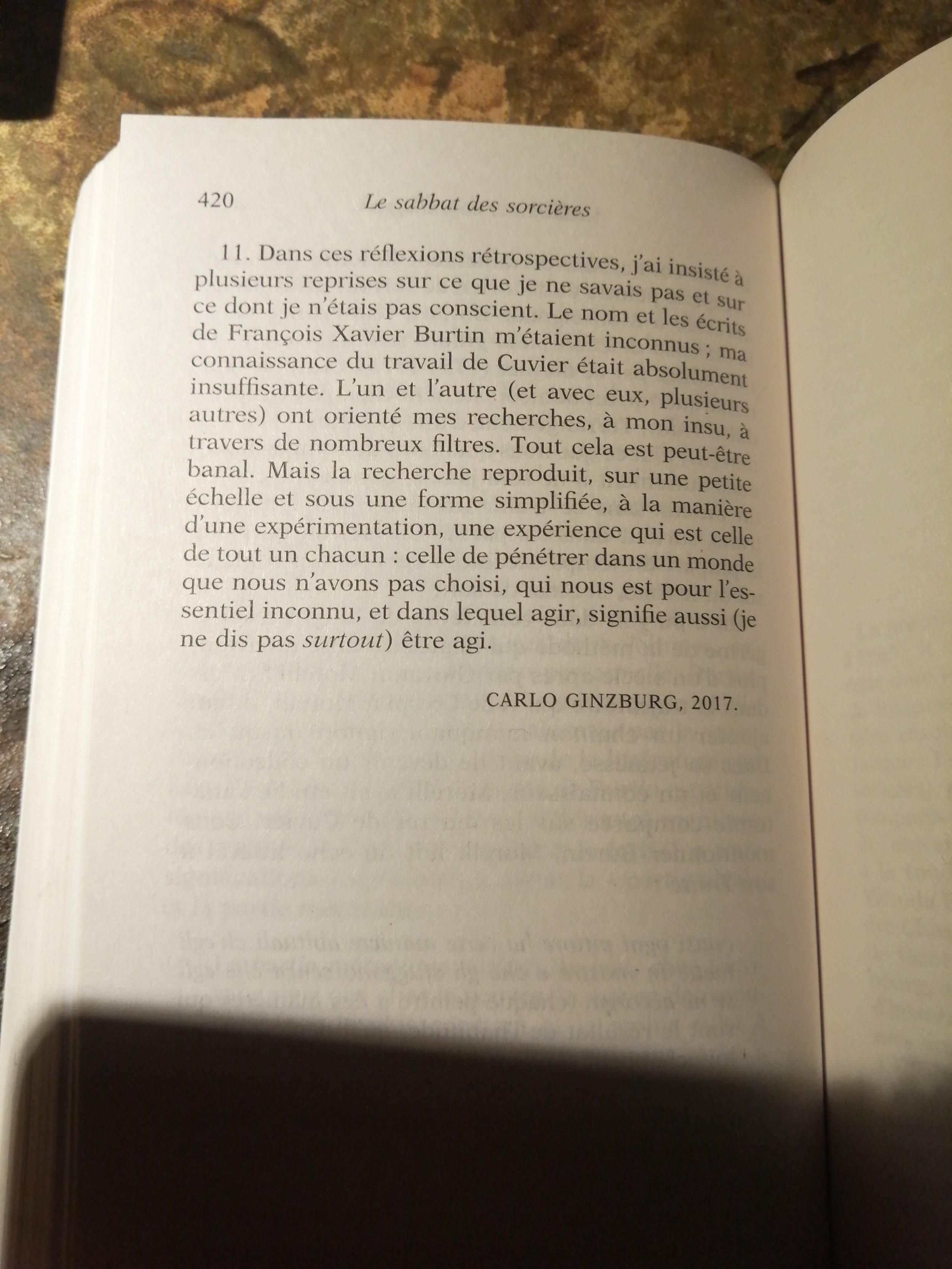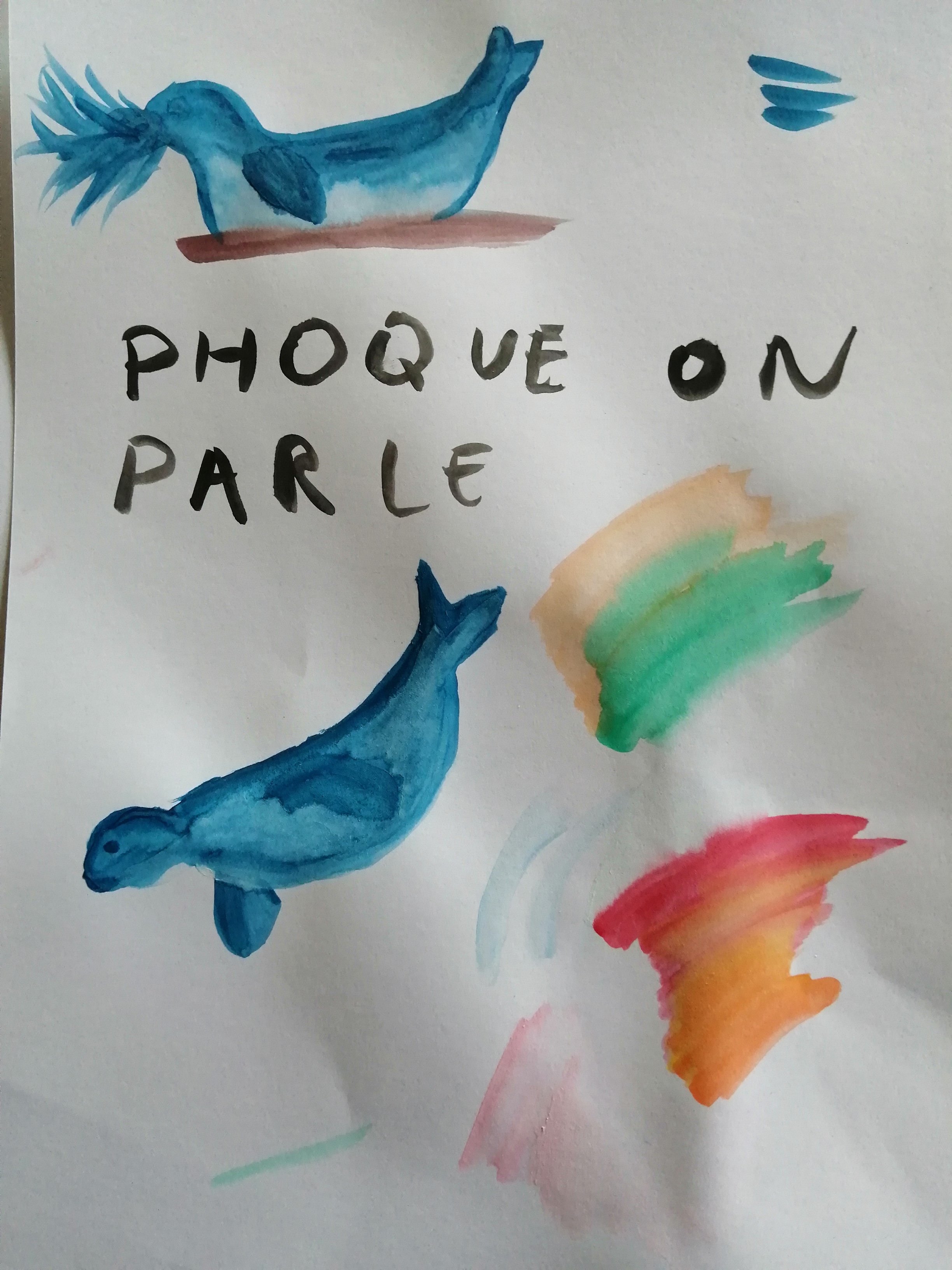L'angoisse du gardien de but au moment du penalty, Handke
Je ne suis pas un grand amoureux du personnage de l’auteur, notamment au regard de ses positions sur la guerre d’ex-Yougoslavie, mais ce livre est un modèle d’efficacité narrative. Je n’ai pas vu le film que Wenders en a tiré. On se demande souvent si l’art peut changer le monde. Je n’en suis pas convaincu, mais ce petit ouvrage a agité ma vie, m’a incité à accueillir l’évidence, quand j’ai une tendance naturelle à trop penser, imaginer des complications existentielles qui n’ont pas lieu d’être.
Ce roman où l’auteur évoque sa mère avec une nostalgie étrangement distanciée, si mes souvenirs sont bons, me fait souvent office de raison pratique, me mène dans une sorte de sécheresse vitale, une diète de scrupules. Un Epictète du XXème siècle, qui rappelle qu’il suffit généralement de ne pas bouger pour parvenir à stopper la frappe du tireur. Le but de nos vies étant d’encaisser le moins de penaltys possibles, apparemment.